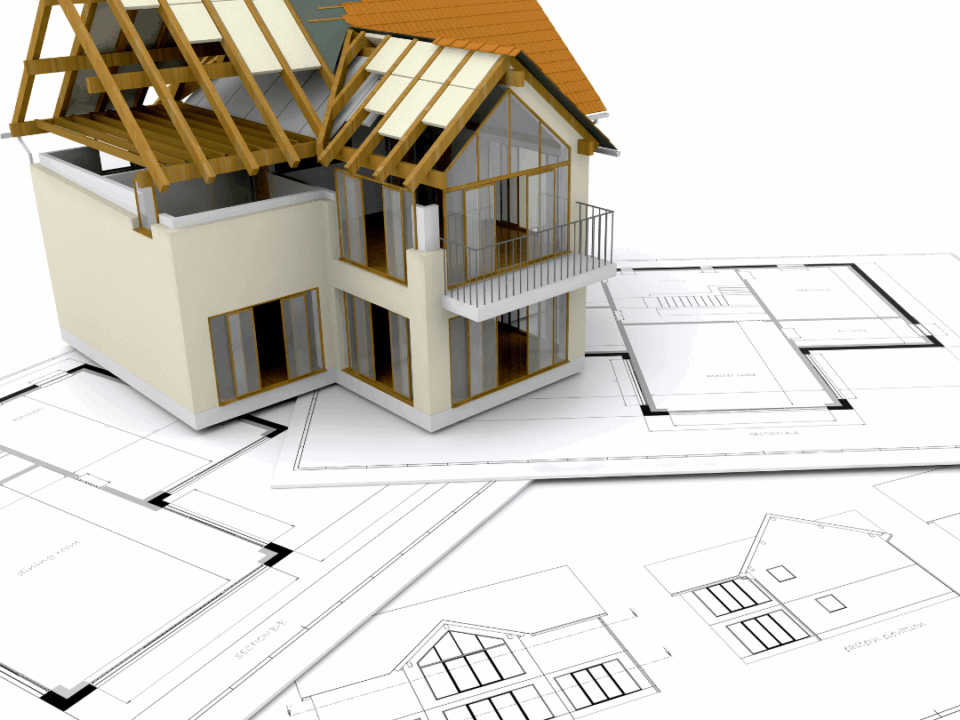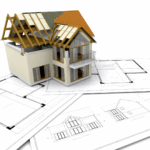
Les obligations en matière d’assurance pour les travaux
26 août 2025Les servitudes de passage : droits, obligations et litiges fréquents
Lorsqu’un terrain ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique, son propriétaire peut se retrouver dans une situation complexe : comment rejoindre la route sans traverser le terrain voisin ?
C’est dans ce type de configuration qu’intervient la servitude de passage, un mécanisme juridique ancien mais toujours d’actualité.
Souvent méconnue, cette servitude soulève de nombreuses questions : qui y a droit ? comment la mettre en place ? quelles sont les limites à son usage ? Et surtout, que faire en cas de litige entre voisins ?
Dans cet article, nous vous éclairerons sur les règles essentielles, les droits et obligations de chacun, ainsi que sur les solutions possibles en cas de conflit.
Qu’est-ce qu’une servitude de passage ?
Définition juridique et origine du droit de passage
La servitude de passage est un droit réel immobilier qui confère à un propriétaire la possibilité de passer sur le terrain d’autrui pour accéder à la voie publique.
Ce droit, encadré par les articles 682 et suivants du Code civil, vise à éviter qu’un propriétaire ne se retrouve isolé et dans l’impossibilité d’utiliser pleinement son bien.

Dans ce dispositif, on distingue :
- le fonds dominant, c’est-à-dire le terrain bénéficiaire du passage ;
- le fonds servant, le terrain sur lequel la servitude s’exerce.
La servitude de passage est attachée au bien et non à la personne. Autrement dit, si la propriété est vendue, la servitude continue de s’appliquer au nouveau propriétaire.
Les conditions d’existence d’une servitude de passage
Pour qu’une servitude de passage soit reconnue, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Le fonds doit être enclavé ou disposer d’un accès insuffisant à la voie publique.
- Le passage doit être nécessaire à l’usage du bien, et non simplement commode.
- L’accès doit être établi de manière proportionnée, en évitant de causer un préjudice excessif au voisin.
On distingue principalement deux types de servitudes :
- La servitude légale, imposée par la loi en cas d’enclavement réel. Elle ouvre droit à une indemnité versée au propriétaire du terrain traversé.
- La servitude conventionnelle, décidée d’un commun accord entre voisins et formalisée devant notaire. Elle peut par exemple être consentie pour faciliter un accès plus direct, sans situation d’enclavement.
En l’absence d’accord, le juge peut fixer le tracé du passage, sa largeur, sa destination et le montant de l’indemnité.
Les différents types de servitude de passage
Outre les servitudes légales et conventionnelles, il existe :
- La servitude par destination du père de famille, créée lorsqu’un propriétaire divise son terrain en plusieurs lots et laisse un passage utilisé antérieurement.
- Les servitudes apparentes et continues, matérialisées par des signes visibles (chemin, portail, tranchée, etc.).
- Les servitudes non apparentes, qui existent sans manifestation visible mais qui figurent dans un acte notarié.
Chaque type de servitude implique un régime juridique différent, notamment en matière de preuve et de prescription.
Les droits et obligations des propriétaires concernés
Les droits du propriétaire enclavé (fonds dominant)
Le propriétaire du terrain enclavé a droit à un passage suffisant pour accéder librement à la voie publique.
Ce droit doit permettre un usage normal du bien : accès piéton, circulation de véhicules, livraisons, travaux, etc.
Toutefois, ce droit n’est pas illimité. Il doit s’exercer :
- dans le respect du voisin ;
- sans détériorer le terrain emprunté ;
- en respectant l’usage défini (par exemple, passage piéton seulement).
Le propriétaire du fonds dominant a également la charge de l’entretien du passage, sauf clause contraire dans la convention.
Les obligations du propriétaire du terrain traversé (fonds servant)
Le propriétaire du fonds servant ne peut s’opposer à l’exercice du passage dès lors que la servitude est légalement ou conventionnellement établie.
Il doit permettre le libre accès, mais conserve la propriété du sol.
En contrepartie, il bénéficie :
- d’une indemnisation financière, fixée d’un commun accord ou par le juge, en compensation de la gêne ou de la perte de valeur du terrain ;
- du droit d’exiger que le passage cause le moins de dommage possible à sa propriété.
Toute entrave au passage (clôture, véhicule gênant, plantation d’arbres, etc.) peut être sanctionnée juridiquement.
L’entretien, la largeur et la localisation du passage : comment les fixer ?
Ces éléments sont essentiels pour éviter les litiges.
En principe :
- La localisation du passage est choisie de manière à minimiser la gêne pour le fonds servant.
- La largeur dépend de l’usage : un passage agricole ou pour véhicules nécessitera plus d’espace qu’un simple accès piéton.
- L’entretien du passage incombe au propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire.
Un accord clair, idéalement rédigé par un notaire ou un avocat, reste la meilleure garantie de tranquillité à long terme.

Les litiges fréquents et leurs solutions juridiques
Contestation du tracé ou de l’usage du passage
Les litiges relatifs aux servitudes de passage sont nombreux.
Ils concernent souvent :
- le tracé du passage, jugé trop contraignant ou mal placé ;
- l’étendue du droit d’usage (passage à pied ou en véhicule) ;
- le montant de l’indemnité versée au propriétaire du fonds servant.
En cas de désaccord, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour statuer.
Le juge peut ordonner une expertise foncière pour évaluer la meilleure configuration du passage.
Trouble de jouissance et abus d’usage
Un autre motif fréquent de conflit concerne les abus d’usage.
Certains propriétaires du fonds dominant utilisent le passage au-delà de ce qui est prévu : stationnement prolongé, passage de véhicules lourds, nuisances sonores…
Inversement, le propriétaire du fonds servant peut obstruer le passage ou limiter son usage sans autorisation.
Dans les deux cas, le comportement fautif peut être sanctionné, et des dommages et intérêts peuvent être accordés à la partie lésée.
Comment résoudre un litige de servitude ?
Avant d’envisager une action en justice, il est conseillé de tenter une résolution amiable :
- Consultation d’un avocat en droit immobilier, qui pourra évaluer la validité de la servitude, formaliser un accord écrit ou préparer une action judiciaire.
- Discussion directe entre voisins, appuyée sur les documents de propriété.
- Médiation ou conciliation, notamment par un conciliateur de justice.

Si le conflit persiste, la voie judiciaire permet d’obtenir :
- la reconnaissance ou la suppression d’une servitude irrégulière ;
- la définition du tracé et de la largeur ;
- ou encore la fixation de l’indemnité compensatoire.
Les servitudes de passage représentent un équilibre subtil entre le droit de propriété et la nécessité d’accès.
Elles doivent être définies avec précision et exercées dans le respect mutuel, sous peine de générer des tensions de voisinage parfois durables.
Pour éviter les erreurs ou sécuriser un accord, l’assistance d’un avocat en droit immobilier s’avère précieuse.
Morgane Deswarte, avocate à Valence, conseille et accompagne aussi bien les propriétaires enclavés que les propriétaires de terrains traversés.